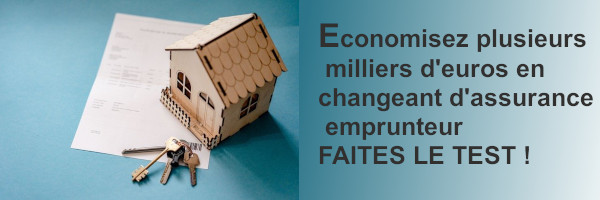Les différents stades de la hernie discale chez le chien : comprendre, détecter et agir
La hernie discale est l’une des affections neurologiques les plus fréquentes chez le chien, en particulier chez certaines races comme le teckel, le bouledogue français ou le beagle. Elle peut provoquer des douleurs intenses, une perte de mobilité, voire une paralysie. Pourtant, bien comprise et prise en charge à temps, elle peut être traitée efficacement.
Dans cet article, nous allons explorer en détail les différents stades de la hernie discale chez le chien, leurs signes cliniques, les causes sous-jacentes et les options de traitement disponibles à chaque étape.
Qu’est-ce qu’une hernie discale ?
Pour comprendre la maladie, il faut d’abord savoir ce qu’est un disque intervertébral. Entre chaque vertèbre de la colonne du chien se trouve un disque, sorte de petit coussin amortisseur composé d’un noyau gélatineux (nucléus pulposus) et d’une enveloppe fibreuse (annulus fibrosus).
Ces disques permettent la flexibilité de la colonne et amortissent les chocs lors des mouvements.
Une hernie discale se produit lorsque ce noyau gélatineux se déplace ou s’échappe de sa position normale, comprimant la moelle épinière ou les nerfs rachidiens. Cette compression est à l’origine des douleurs et des troubles neurologiques.
Les causes et les races prédisposées
Deux grands types de hernie discale existent chez le chien :
- Type I (hernie aiguë) : fréquente chez les chiens dits chondrodystrophiques (races à pattes courtes et dos long, comme le teckel, le shih tzu ou le bouledogue). Le noyau du disque dégénère prématurément, durcit et finit par se rompre brutalement. Ce sont les espèces les plus sujettes à des hernies discales. Lombaires le plus souvent pour les teckels et hernies discales cervicales pour les bouledogues ( ce sont des races pour lesquelles il est très recommandé de prendre une mutuelle vétérinaire
- Type II (hernie chronique) : observée surtout chez les chiens plus âgés de grandes races (berger allemand, labrador, etc.). Le disque se déforme progressivement et vient compresser lentement la moelle épinière.
D’autres facteurs aggravants peuvent intervenir : obésité, traumatismes, efforts physiques intenses, vieillissement ou prédisposition génétique.
Les différents stades de la hernie discale chez le chien
Les vétérinaires classent généralement la gravité de la hernie discale en cinq stades cliniques, selon le degré de compression de la moelle épinière et la sévérité des symptômes neurologiques.
Cette classification aide à déterminer le pronostic et la stratégie thérapeutique.
Stade 1 : Douleur seule, sans atteinte neurologique
Symptômes :
Le chien manifeste une douleur dorsale ou cervicale sans perte de mobilité. Il peut :
- Pleurer lorsqu’on le porte ou le touche au dos ;
- Refuser de sauter, de monter les escaliers ou de jouer ;
- Présenter une raideur du cou ou du dos ;
- Adopter une posture anormale, dos voûté.
Prise en charge :
À ce stade, un repos strict (minimum 3 à 6 semaines), associé à des anti-inflammatoires et des antalgiques, peut suffire à rétablir la situation.
Des séances de physiothérapie douce ou de laserthérapie peuvent accélérer la récupération.
Pronostic : Excellent si le chien est traité rapidement et correctement surveillé.
Stade 2 : Faiblesse ou incoordination des membres
Symptômes :
La douleur persiste, mais le chien commence à montrer :
- Une démarche hésitante ou chancelante ;
- Des pattes arrière qui glissent sur le sol ;
- Une perte partielle de coordination (ataxie).
Prise en charge :
Le traitement médical est encore possible, mais le repos strict devient impératif. Si l’état ne s’améliore pas après quelques jours ou si les signes s’aggravent, une imagerie (IRM ou scanner) est recommandée pour évaluer la compression.
Pronostic : Bon à très bon si la progression est stoppée à temps.
Stade 3 : Paralysie partielle (sans perte de la douleur profonde)
Symptômes :
Le chien ne parvient plus à marcher, mais peut encore bouger volontairement ses pattes ou ressentir la douleur lorsqu’on pince les doigts.
C’est un signe que la moelle épinière est encore fonctionnelle, mais sévèrement comprimée.
Prise en charge :
À ce stade, une intervention chirurgicale devient souvent nécessaire pour décompresser la moelle épinière (hémilaminectomie, fenestration, etc.).
Après l’opération, une période de rééducation est indispensable : massages, hydrothérapie, exercices progressifs.
Pronostic : Bon, à condition que la chirurgie soit réalisée rapidement (dans les 24 à 48 heures).
Stade 4 : Paralysie complète, mais avec perception de la douleur
Symptômes :
Le chien est totalement paralysé des membres postérieurs, mais il ressent encore la douleur profonde.
Il peut aussi perdre le contrôle de la vessie ou des intestins.
Prise en charge :
La chirurgie est urgente. Plus le temps passe, plus les chances de récupération diminuent.
Un suivi post-opératoire rigoureux (soins d’hygiène, physiothérapie quotidienne, gestion des escarres) est essentiel.
Pronostic : Réservé, mais une récupération est possible si la douleur est encore perçue et si le traitement est rapide.
Stade 5 : Paralysie complète sans douleur profonde
Symptômes :
C’est le stade le plus grave. Le chien :
- Ne peut plus marcher ni bouger ses pattes ;
- Ne réagit plus du tout à la douleur profonde ;
- Peut présenter une incontinence totale.
Prise en charge :
La chirurgie est la seule façon d’améliorer la situation, mais le pronostic n’est pas bon si la perte de sensation persiste depuis plus de 48 heures.
Certains chiens récupèrent partiellement, mais la plupart gardent des séquelles irréversibles.
Pronostic : Défavorable. Dans certains cas, les vétérinaires peuvent envisager des soins palliatifs ou, dans les situations extrêmes, une euthanasie.
Le diagnostic : imagerie et examens neurologiques
Le diagnostic précis d’une hernie discale repose sur :
- Un examen clinique et neurologique complet ;
- Des radiographies (pour exclure d’autres causes) ;
- Une IRM ou un scanner, qui permet de localiser et de quantifier la hernie.
Ces examens sont indispensables avant toute chirurgie, car ils indiquent la localisation exacte du disque endommagé.
La rééducation et la prévention
Après un épisode de hernie discale, la rééducation fonctionnelle est capitale :
- Hydrothérapie (tapis roulant sous l’eau) pour renforcer les muscles sans contrainte ;
- Physiothérapie manuelle ;
- Stimulation électrique ou laser thérapeutique.
Côté prévention, certaines précautions permettent de limiter les risques chez les espèces à risque :
- Maintenez un poids de forme chez votre chien ;
- Évitez les sauts ou les escaliers pour les races à risque ;
- Apprenez à votre chien à ne pas tirer sur sa laisse pour ne pas solliciter la colonne ;
- Offrez un repos suffisant après chaque effort physique.
En conclusion : La hernie discale du chien, une prise en charge rapide peut tout changer !
La hernie discale chez le chien n’est pas une fatalité. Détectée précocement et prise en charge de manière adaptée, elle peut être soignée avec d’excellents résultats.
Le plus important reste la réactivité des maîtres : dès les premiers signes de douleur ou d’anomalie dans la démarche, une consultation vétérinaire s’impose.
Chaque stade représente une urgence de gravité croissante : agir tôt, c’est offrir à son chien la meilleure chance de retrouver sa mobilité et son confort de vie.